Ce chapitre se limite à des généralités sur le milieu marin, utilisées par la suite. L'étude détaillée des régimes des vents (qui expliquent les voltas des navigateurs ibériques au temps des Grandes Découvertes) et des courants, la formation et la propagation des vagues, la théorie des marées sont des sujets étudiés en détail par l'océanographie.
1.1 Repères
1.1.1 Unités
Un lieu donné est situé par ses coordonnées géographiques : latitude (L), de 0 à 90°
de l'équateur vers le nord (N) et le sud (S), et longitude (G), de 0 à 180° à partir du méridien
de Greenwich vers l'est (E) et l'ouest (W).
Le méridien de Greenwich est la référence internationale adoptée en 1884. Avant cette date presque
chaque pays avait la sienne : méridien de Paris, Lisbonne, Madrid, Rome, Washington... On fera donc
attention lors de la lecture des cartes anciennes.
Les directions sont indiquées en degrés : 0 ou 360° au nord, 90° à l'est, 180° au sud et 270° à l'ouest, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sens dépend du sujet,
- cap, relèvement au 270° : vers l'ouest,
- courant au 245° : porte vers le 245°,
- vent du SE, de terre : vient du sud-est, de la terre.
Pour les divers calculs on prendra les longitudes est positives, ouest négatives et les latitudes nord positives, sud négatives. En regardant vers le ciel, l'axe W-E est celui des sinus, S-N l'axe des cosinus ; les caps respectent ainsi le sens trigonométrique, l'interprétation des résultats de calculs est facilitée (la fonction atan2 retourne de -180 à +180°, si < 0 il suffit d'ajouter 360°).
L'unité de distance est le mille marin : M = 1852 mètres, longueur moyenne d'un arc d'une minute de latitude sur le globe terrestre (conférence hydrographique internationale de 1929) ; celle de vitesse le noeud (kn) : un mille à l'heure. Les hauteurs d'eau, des feux, les altitudes sont exprimées en mètres.
Remarque : mille s'écrit avec deux L en français, un seul en anglais (nautical mile). En français on dit simplement nautique pour éviter la confusion entre 10 milles nautiques et 10 000 nautiques ! Le mille terrestre anglo-saxon fait 1609 mètres (aux USA statute mile).
1.1.2 Estime
Avant tout moyen de se situer la seule aide à la navigation fut l'estime, c'est à dire connaître :
- Le cap suivi grâce à une aiguille aimantée flottant dans un récipient, puis la boussole (aiguille sur pivot, XIIIe siècle) et enfin le compas (barreaux aimantés solidaires de la rose). La rose des vents était divisée en 32 directions (les vents principaux) ou rhumbs ; en reste le quart de 11° ¼ estimé par la largeur du poing, bras tendu.
- La distance parcourue suivant la vitesse du navire. Celle-ci était mesurée à l'aide d'une bûche (log devenu loch) jetée à l'eau et dont on mesurait le temps mis à longer le navire, puis du loch à bateau (XVIIe siècle) en comptant le nombre de noeuds de la ligne filée pendant 30 secondes (intervalle entre noeuds de 14,62 mètres, inférieur à la théorie pour corriger l'entraînement du dispositif). Le loch à hélice remorquée (sillomètre, XIXe) entraîne un compteur totalisateur de distance.
1.2 Vent, courants et vagues
1.2.1 Vents
L'alternance de hautes (anticyclones) et basses (dépressions) pressions dues à la température et la déviation provoquée par la rotation de la Terre induisent une circulation générale de l'atmosphère : en Atlantique vents dominants d'est aux régions polaires, d'ouest aux latitudes moyennes, d'est aux tropiques (les alizés) séparés par des calmes à l'équateur (le pot au noir). Ce schéma théorique est modifié par les masses continentales. D'autre part les variations saisonnières et les perturbations météorologiques modifient ce régime général.
Un observateur face au vent a l'anticyclone à sa gauche et la dépression à sa droite dans l'hémisphère nord ; le vent a tendance à tourner autour de la dépression en sens antihoraire. C'est l'inverse dans l'hémisphère sud.
La différence de température entre terre et mer engendre la brise thermique, de mer le jour, de terre la nuit. Le vent observé en région côtière sera la combinaison de celle-ci avec le vent synoptique donné par les bulletins météorologiques.
Le vent est dévié dans les plans horizontal et vertical par le relief des côtes. Il est ralenti par frottement à la surface de l'eau : sa force (vitesse) varie entre pied et tête de mât d'un voilier.
Les Pilot charts ( NOAA) donnent des statistiques des force et direction du vent par région océanique.
1.2.2 Courants
De même que pour la circulation atmosphérique les différences de température entre régions du globe entraînent des courants permanents : chauds (Gulf Stream) remontant des tropiques et froids (Labrador) descendant des régions polaires. Ils varient suivant la saison et influencent les vents dominants. Très lents, l'essentiel des échanges de température se fait par convection via l'atmosphère.
À l'échelle locale des courants sont créés par les différences de niveau (courant de pente) ou de densité des eaux. Outre ces phénomènes permanents existent les courants périodiques des marées (§ 1.3.4) et des courants de dérive induits par un vent fort et persistant, de vitesse environ 2 % celle du vent et de direction infléchie de 45° vers la droite dans l'hémisphère nord.
1.2.3 Vagues
L'action du vent sur une surface d'eau libre engendre des ondulations : de simples rides à de grosses vagues suivant sa force (sa vitesse). Il n'y a pas de déplacement d'eau mais propagation d'une onde déformant sa surface suivant une cycloïde à l'envers.
Les vagues sont caractérisées par leur hauteur H entre crête et creux, les longueur d'onde L et période T entre deux crêtes. La vitesse de propagation est c = L / T m/s en pleine eau ; elle est freinée par une profondeur insuffisante (inférieure à 2 L).
Il n'y a pas de relation directe entre hauteur et longueur mais toutes deux augmentent
avec la force du vent et la durée de son action suivant des lois paraboliques.
Elles sont limitées selon le fetch : distance libre sur laquelle agit le vent.
Les vagues commencent par prendre de la hauteur puis s'allongent : mer formée.
Si leur longueur est limitée elles seront abruptes : mer courte, hachée.
La remontée des fonds, un courant contre le vent ou un phénomène de résonance sur la côte, freinent
leur vitesse de propagation, raccourcissant leur longueur d'onde et élevant leur hauteur. Pour un rapport
de cambrure H / L > 0,13 les vagues s'écroulent : déferlantes, brisants, barre causée par une remontée
du fond (Etel, embouchure de l'Adour).
Au large, un vent fort (> 30 kn) augmente la hauteur des vagues de façon plus importante que leur
longueur, le rapport H / L croît, provoquant leur déferlement.
On appelle houle la propagation de vagues formées au loin, éventuellement annonciatrice d'un vent prochain, ou bien le mouvement résiduel de l'eau si l'action du vent a cessé. De nouvelles vagues peuvent se superposer à une houle résiduelle : mer croisée.
Les raz de marée sont provoqués par des phénomènes météorologiques violents (tempête, ouragan ou cyclone), les tsunamis par des accidents géologiques des fonds sous-marins. Les vagues dites scélérates de hauteur exceptionnelle (20, 30 mètres) se formeraient par regroupement ou par absorption de leurs voisines.
1.2.4 Echelle de Beaufort
Créée en 1805 par un officier de la Royal Navy britannique afin d'estimer la force du vent d'après l'état de la mer. Depuis les bulletins météorologiques donnent les prévisions en degrés Beaufort, donc à la fois la force du vent (sa vitesse moyenne à l'exclusion des rafales qui peuvent être 40% plus fortes) et l'état de la mer.
| Echelle | désignation | force du vent | hauteur des vagues | état de la mer |
|---|---|---|---|---|
| 0 | calme | < 1 kn | 0 m | miroir |
| 1 | très légère brise | 1 à 3 | 0,1 | ridée |
| 2 | légère brise | 4 à 6 | 0,2 à 0,5 | vaguelettes |
| 3 | petite brise | 7 à 10 | 0,6 à 1 | quelques moutons |
| 4 | jolie brise | 11 à 16 | 1 | moutons |
| 5 | bonne brise | 17 à 21 | 2 | moutons, embruns |
| 6 | vent frais | 22 à 27 | 3 à 4 | apparition de traînées d'écume |
| 7 | grand frais | 28 à 33 | 4 à 6 | déferlantes, traînées d'écume |
| 8 | coup de vent | 34 à 40 | 6 à 8 | mer grosse, tourbillons d'écume |
| 9 | fort coup de vent | 41 à 47 | 7 à 10 | mer très grosse |
| 10 | tempête | 48 à 55 | 9 à 12 | mer énorme |
| 11 | violente tempête | 56 à 63 | 12 à 16 | mer énorme |
| 12 | ouragan | > 63 kn | > 14 m | mer énorme |
1.3 Marées
1.3.1 Phénomène
Résultant de l'attraction de la Lune et du Soleil, le phénomène des marées a été étudié par Newton (théorie statique), Laplace (théorie dynamique), Kelvin, Darwin et Doodson (méthode harmonique). Le modèle moderne est basé sur une onde de marée somme d'ondes élémentaires : les harmoniques.
Principe, Lune seule :

La force génératrice de la marée a deux composantes : verticale et horizontale. Le
calcul montre que cette force est symétrique de part et d'autre de la Terre et que sa
composante horizontale est prépondérante. L'action de la Lune étant la plus importante,
environ 2,2 fois celle du Soleil, il y a deux cycles par jour lunaire (mouvement relatif
entre rotation terrestre et orbite lunaire) : marée semi-diurne.
Onde M2, période = 12h 25min.
Actions combinées de la Lune et du Soleil :
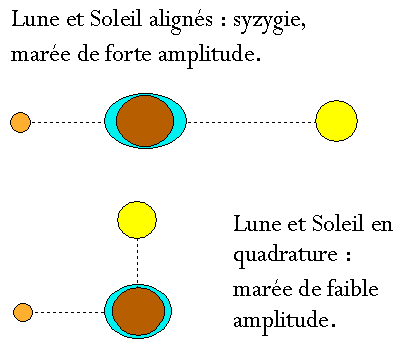
L'action du Soleil est plus faible (sa masse compense son éloignement). Elle renforce
ou contrarie celle de la Lune.
Onde semi-diurne solaire S2, période = 12h 00 (demi jour solaire).
L'opposition du Soleil et de la Lune alignés avec la Terre correspond à la pleine Lune (figure), la conjonction (du même côté de la Terre) à la nouvelle Lune : syzygies. La quadrature correspond aux premier et dernier quartiers de Lune. Il y a alternance de fortes et faibles amplitudes de marée, ce cycle se produit deux fois dans une lunaison (révolution synodique) de 29,53 jours.
Déclinaison des astres :

La déclinaison des astres par rapport à la Terre introduit une dissymétrie d'amplitude,
la composante diurne. La déclinaison peut être telle que la composante semi-diurne
disparaît.
Onde diurne K1, déclinaison Lune / Soleil, T = 23h 56min (jour sidéral) ;
onde diurne O1, déclinaison de la Lune, T = 24h 50min.
Deux autres ondes diurnes : P1 (Soleil) et Q1 (Lune), et semi-diurnes : N2 (Lune) et K2 (lunisolaire), d'amplitudes moindres.
Autres composantes :
À période longue, dues aux variations orbitales : mensuelles, semestrielles (marées
d'équinoxes), annuelles ; le saros est une période de 18 ans et 11,3 jours au bout
de laquelle les astres retrouvent pratiquement la même configuration et les marées sont
similaires.
À période courte (tiers diurne, quart diurne...) : phénomènes d'interaction des ondes,
de résonance causée par la configuration côtière.
Les calculs de prédiction des marées prennent en compte plus de cent composantes.
En réalité l'onde de marée ne suit pas la force génératrice à cause des continents,
de sa vitesse limitée par la profondeur d'eau et de la rotation terrestre. Elle tourne
autour de points fixes, dits amphidromiques, où l'amplitude est nulle ; un est situé
au milieu de l'Atlantique Nord.
L'âge de la marée est le retard entre sysygie et maximum de son amplitude.
L'établissement d'un port est le retard de la marée haute par rapport au passage de la Lune à son méridien.
La progression de la marée dans un bassin maritime est représentée par des lignes d'isomarnage et des
lignes cotidales (même heure de pleine mer).
Types de marées :
- semi-diurne : côtes françaises ;
- diurne : Asie du Sud-Est ;
- semi-diurne à inégalité diurne : sud Vietnam ;
- mixte, tantôt diurne, tantôt semi-diurne : Petites Antilles.
Courants et marées :
- marnage pratiquement nul en Méditerranée mais courants apériodiques (Bouches de Bonifacio, détroit de Gibraltar),
- marnage et courants importants aux Anglo-Normandes,
- courants dépassant les cinq noeuds au Raz Blanchard (Cotentin), à Port Navalo (entrée du golfe du Morbihan),
- très faible marnage en mer des Caraïbes mais courants d'un à deux noeuds entre les Petites Antilles.
1.3.2 Définitions
- marée montante (flot) jusqu'à l'étale de pleine mer (PM),
- marée descendante (jusant) jusqu'à l'étale de basse mer (BM) ;
- intervalle : temps entre étales de PM et BM ou BM et PM,
- heure marée : intervalle divisé en 6 parties ;
- amplitude : différence de hauteurs d'eau entre PM ou BM et niveau moyen,
- marnage : différence de hauteurs d'eau entre PM et BM, approximativement le double de l'amplitude ;
- niveau moyen : hauteur d'eau théorique après correction des effets de la marée, toujours le même pour un lieu donné ; en pratique confondu avec le niveau de mi-marée ;
- coefficient de marée défini pour Brest (Laplace : 100, de 20 à 120, pour une amplitude de 3,05 mètres)
mais pratiquement applicable à toutes les côtes ouest françaises (l'amplitude, spécifique à chaque
lieu, est proportionnelle au coefficient) :
coefficient appellation 120 vive-eau maximale 95 vive-eau moyenne 70 marée moyenne 45 morte-eau moyenne 20 morte-eau maximale
1.3.3 Calculs de marée
L' Annuaire des marées, Ports de France du SHOM ainsi que ceux d'éditeurs privés donnent les coefficients et
- les heures et hauteurs d'eau de PM et BM pour les ports principaux,
- les corrections de hauteurs et heures à appliquer aux données du port de référence pour environ 250 ports rattachés suivant les marées de vive (VE) et morte-eau moyennes (ME). Pour un autre coefficient prendre le cas le plus proche : VE, ME ou la moyenne des corrections VE et ME pour une marée moyenne.
Les heures sont indiquées en temps légal (en France : TU + 1 en hiver, TU + 2 en été), les hauteurs par rapport aux sondes des cartes : plus basses mers connues (pour un coefficient de 120 : zéro hydrographique). Les calculs répondent aux deux questions : quelle hauteur d'eau à telle heure et réciproquement à quelle heure telle hauteur d'eau.
a) Approximation sinusoïdale
Trois méthodes de calcul pour une marée semi-diurne, considérant une variation sinusoïdale des hauteurs d'eau :
Δh = 0,5 H (1 - cos t) avec H = marnage (> 0 si flot, < 0 si jusant) et t = π (temps écoulé / intervalle)
- calcul suivant la règle des douzièmes :
heure marée douzième variation de hauteur d'eau 1ère 1/12 1/12 marnage 2e 2/12 3/12 soit ¼ marnage 3e 3/12 6/12 soit ½ marnage 4e 3/12 9/12 soit ¾ marnage 5e 2/12 11/12 marnage 6e 1/12 12/12 marnage (étale) - utilisation des abaques SH4 du SHOM : entrée directe des horaires dans la première et des hauteurs dans la seconde, correspondance suivant les centièmes d'intervalle ;
- tracé d'un demi-cercle divisé en 6 heures marée, le diamètre représente le marnage.
On ajoute la valeur de Δh au niveau initial de BM ou on retranche de celui de PM. Attention, si la hauteur d'eau et l'heure sont pratiquement sûres pour la mi-marée, on ne prendra les quarts que pour des marnages importants (> 4m) et des courbes de marées proches d'une sinusoïde ; le douzième des première et dernière heures est illusoire.
b) Courbes types

Plus précises que le calcul précédent, on utilise des courbes types, pour les ports principaux seuls :
- deux courbes entre moins et plus 4 heures marée autour de la PM pour les coefficients 45 et 95 ; l'heure marée est en abscisse et un facteur en ordonnée, de 0 à 1, que l'on applique au marnage pour obtenir la hauteur d'eau Δh (interpolation du facteur pour d'autres coefficients) ;
- deux courbes autour de la BM, même principe.
On ajoute ensuite Δh au niveau initial de BM.
c) Tables de hauteurs d'eau
Enfin, pour des cas particuliers (Le Havre), les hauteurs d'eau sont données heure par heure dans des tables.
d) Profondeur
La hauteur calculée ajoutée à la sonde sur la carte donne la profondeur d'eau à l'endroit considéré. Ces calculs à la minute et au centimètre près sont théoriques, par prudence prendre une marge : le "pied du pilote" (augmente avec l'âge du capitaine).
Le vent joue sur la hauteur d'eau par entraînement : marée éolienne (un vent du large augmente la hauteur d'eau et inversement), ainsi que la pression atmosphérique : marée barométrique (+ 10 cm pour - 10 mbar et inversement).
Sur les anciens documents britanniques les sondes étaient ramenées au niveau des basses mers de vives-eaux moyennes et étaient exprimées en brasses (phatom = 1,83 m) ou en pieds (0,305 m).
1.3.4 Courants de marée
Le déplacement d'eau se traduit par un courant, alternatif si flot et jusant sont opposés avec renverse aux étales, ou plus souvent giratoire, c'est à dire portant successivement vers toutes les directions au cours de la marée.
Les courants sont indiqués sur les cartes soit par un graphique polaire, soit dans un tableau donnant par heure de la montre (négative avant la PM, positive après) :
- la direction,
- la vitesse en noeuds pour les coefficients 45 et 95 (interpoler pour les autres coefficients).
La règle des sixièmes donne la vitesse des courants alternatifs, découlant de l'approximation sinusoïdale :
| heure marée | vitesse du courant |
|---|---|
| 1ère | 3/6 soit ½ vitesse maxi |
| 2e | 5/6 de vitesse maxi |
| 3e | 6/6 soit la vitesse maxi |
| 4e | 5/6 de vitesse maxi |
| 5e | 3/6 soit ½ vitesse maxi |
| 6e (étale) | nulle |
ce calcul reste théorique, il y a souvent un décalage entre étale et courant nul.
Les courants sont déviés par le relief des côtes, ralentis par une faible profondeur, accélérés dans les goulets.
Le SHOM édite des Atlas de courants de marée détaillés pour les côtes françaises.
1.4 Balisage, feux et signaux
1.4.1 Balises
Les balises sont soit des tourelles ou des perches sur le fond, soit des bouées avec un pylône, surmontées d'un voyant. Elles peuvent comporter en plus un feu de nuit, un réflecteur ou un répondeur (RACON) radar, un dispositif sonore (cloche, corne).
Le système international de balisage normalisé par l'AISM ou IALA est effectif depuis avril 1982. Il est composé des
- marques latérales : balisage des chenaux, vert à tribord, marque conique, et rouge à bâbord, marque cylindrique, en entrant au port en région A (Europe, Afrique et Asie) ; couleurs inversées en région B (Amérique) ;
- marques cardinales N, S, E et W : signalisation de dangers, par ex. bouée ouest passer à son ouest ;
- marques de danger isolé, d'eaux saines (entrées de chenaux) et spéciales (sans voyant : balisage des plages).
De plus des alignements ou des amers sont repérés par des marques de forme et couleur variées, parfois simplement peintes sur des constructions diverses.
L'ancien balisage français décrit dans les ouvrages antérieurs à 1982 comprenait ces éléments avec les mêmes voyants, mais les marques latérales étaient respectivement noire et rouge, les cardinales blanche et rouge ou blanche et noire. Il était complété par des marques d'épave est et ouest vertes. Le système cardinal n'était pratiquement utilisé qu'en France.
1.4.2 Feux et phares
Un feu est caractérisé par ses
- couleur : blanc, rouge, vert, jaune... ;
- type : fixe, à éclats, à occultations, isophase, scintillant, mixte ;
- rythme : temps respectifs de lumière et d'obscurité ;
- période : temps du cycle ;
- portées lumineuse et géographique.
Les marques de balisage ont un feu de couleur et type suivant leur catégorie. Existent aussi des feux particuliers : directionnels, d'alignements, à secteurs (couleurs différentes suivant la zone sûre ou dangereuse, se reporter à la carte).
La portée nominale (lumineuse) est la distance calculée, suivant l'intensité du faisceau en candelas, pour une visibilité de 10 M. La portée géographique dépend des hauteurs de l'observateur (h) et du feu (H, par rapport à une PM de coefficient 95, corrigée de la marée), donnée par une abaque ou la formule (§ 3.3.2) : d = 2,08 ( h½ + H½ ).
Un phare est un feu à grande portée, construit généralement en hauteur. Il ne signale pas spécialement un danger mais sert de repère aux navires au large.
Les ouvrages Feux et Signaux de brume du SHOM donnent les caractéristiques des feux et phares par zone.
1.4.3 Signaux divers
- Signaux de brume : cloche, corne, sifflet, sirène ;
- d'entrée et sortie de port : voyants (cônes, boules et pavillons) ou feux le jour, feux la nuit ;
- de marée : voyants le jour, feux la nuit ;
- d'avis de tempête : idem.
© G. Navarre, 2006. Màj 11/02/2025.