Suivant les constructeurs les différents instruments électroniques
sont en modules séparés, échangeant leurs données via un bus, ou bien
les différents capteurs sont branchés sur une centrale de navigation.
L'affichage est analogique ou numérique. Le traitement comprend :
- la conversion du signal physique en grandeur mesurée,
- la correction par des facteurs d'étalonnage,
- le lissage de la valeur affichée (rarement paramétrable),
- l'interface d'exportation de la mesure.
Seul leur principe est mentionné pour comprendre leurs performances. On peut regretter d'ailleurs l'absence de ces informations dans les documentations des constructeurs, ce ne sont pas des secrets...
7.1 Compas
Le compas magnétique classique a été longtemps le seul indicateur de cap. Depuis les appareils électroniques ont l'avantage de fournir en sortie un signal exploitable par les autres instruments.
7.1.1 Flux gate
Principe : deux capteurs flux gate croisés à 90° donnent les composantes horizontales Hx et Hy du champ magnétique H. La direction est calculée par arctg(Hy / Hx) et traduite en cap compas. Résolution de l'ordre du degré (illusoire ?).
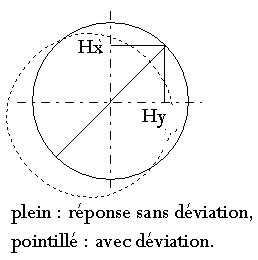
Compensation : sans déviation Hx2 + Hy2 = H2 ;
en négligeant l'effet des fers doux (varie suivant le cap) devant celui des fers durs
(constant), les corrections seront, par couple de directions opposées à 180° :
ΔHx = (Hx1 - Hx2) / 2
et ΔHy = (Hy1 - Hy2) / 2.
Cette méthode est automatisée : le bateau décrit un ou plusieurs cercles à vitesse
réduite et angle de barre rigoureusement constants pendant l'opération.
On établit ensuite la courbe de déviation résiduelle. Mêmes précautions à prendre que pour les compas classiques (§ 3.1.3).
7.1.2 Autres systèmes
- Capteurs en circuits intégrés (compacts et bon marché) :
- à magnétorésistance (par ex : téléphones mobiles ayant une fonction boussole) ;
- à effet Hall : le champ magnétique terrestre est trop faible pour une indication acceptable. - Le gyrocompas conserve la direction du Nord vrai à
± 0,5° (indépendant de la déclinaison, reste seule sa déviation :
Cv = Cg + d). L'appareil demande un délai de stabilisation après mise en marche, l'indication doit être corrigée (manuel ou automatique) suivant la vitesse du navire et la latitude ; il est momentanément dévié lors des virements du navire et dérive dans le temps, nécessitant un recalage périodique.
Utilisé par la marine marchande, cet appareil complexe (mécanique et électronique) a peu de chance de se retrouver en plaisance, quoiqu'il ne faille jurer de rien... - Compas satellitaire : le cap vrai est déduit de la différence des signaux reçus par deux ou trois antennes GPS, corrigé des mouvements du bateau mesurés par un capteur d'accélération trois axes. Ses applications sont la stabilisation en azimut de l'image radar et la compensation des mesures des sondeur et sonar. Son prix le réserve plutôt aux applications professionnelles.
- Le GPS donne la route fond par moyenne mobile de différences de positions, ce n'est pas une mesure instantanée.
Remarque : On parle souvent de compas magnétiques et électroniques. En fait on devrait distinguer les appareils basés sur la mesure du champ magnétique terrestre (magnétique classique, flux gate, magnétorésistance) et ceux utilisant un principe physique autre (gyrocompas, satellites...).
7.2 Indicateur de vitesse
Alors que le sillomètre (§ 1.1.1) enregistrait la distance parcourue tous les appareils modernes mesurent la vitesse ; la distance est enregistrée par intégration. On parlera de speedometer pour l'indicateur de vitesse et de loch pour la distance, journalier et totalisateur.
Les principes physiques sont les mêmes que pour les mesures de débit de fluides dans les conduites.
7.2.1 Roue à aubes
Système le plus employé en plaisance : l'hélice remorquée du sillomètre a été miniaturisée, placée sous la carène par un passe-coque, et simplifiée du simple croisillon à quatre aubes profilées.
Des aimants placés dans les aubes permettent de mesurer la vitesse de rotation de la roue par capteur à reluctance variable, courant de Foucault (sensible à basse vitesse) ou effet Hall, le plus utilisé. La vitesse est proportionnelle à la fréquence du signal f = p N (p nombre d'aimants, N vitesse de rotation). Gamme jusqu'à 50 ou 60 kn.
Une sonde de température (thermistance) est souvent associée au capteur, outre l'intérêt pour la baignade cela permet de repérer une veine de courant.
7.2.2 Montage et étalonnage
Montage : respecter les instructions du constructeur. En particulier le capteur doit être éloigné des remous provoqués par les appendices (aileron, passe-coque...) et hors de la couche limite (dont l'épaisseur dépend de la propreté de la coque et de la vitesse). Il doit être nettoyé régulièrement.
Etalonnage : en ajustant les coefficients a et b de la relation entre vitesse et signal : v = a f + b, soit par relèvements (§ 3.3.1), soit à l'aide du GPS en l'absence de dérive due au vent et au courant, et pour des vitesses différentes.
Précision : peut être excellente, 2%, dans une plage d'utilisation restreinte et suite à un étalonnage soigné, médiocre aux extrêmes : la linéarité de réponse du capteur n'est pas parfaite. Une résolution du dixième de noeud, même si non significative dans l'absolu, est nécessaire pour juger de l'incidence d'un réglage du moteur ou des voiles.
7.2.3 Autres systèmes
- Electromagnétique (société Ben, adaptation d'un principe de débitmétrie, repris
depuis par d'autres constructeurs) : séduisant car sans pièces mobiles ce système ne dispense
pas des mêmes précautions que pour le précédent. La vitesse est proportionnelle à la force
électromotrice U induite dans le capteur par le déplacement de l'eau :
v ∝ U / B L (B champ d'induction, L dimension du capteur) - Effet Doppler : la vitesse est déduite de la différence de fréquences entre faisceaux d'ultrasons
(440 kHz à 1 MHz) émis et réfléchi :
v ≈ c (fr - fe) / 2 fe pour v << c (célérité du son dans l'eau)
Donne la vitesse fond lorsque la réflexion est sur le fond sous-marin (mode fond), sinon sur une différence de couches d'eau ou des micro bulles (mode masse d'eau) la vitesse mesurée n'est pas strictement de surface. Utilisé par la marine marchande, il apparaît maintenant pour la plaisance. - Tube de Pitot : pression d'eau dans un tube dont l'ouverture est dirigée vers l'avant, proportionnelle au carré de la vitesse (Bernoulli). Utilisé sur les canots à moteur, ce principe est maintenant abandonné au profit de la roue à aubes.
- Compte tours : par étalonnage en fonction des états de la mer les tours moteur ou hélice sont d'excellents indicateurs de vitesse.
- GPS : donne la vitesse fond (effet Doppler).
7.3 Anémomètre et girouette
L'anémomètre et la girouette mesurent la force et l'angle du vent apparent. Connaissant la vitesse du bateau le module calcule les force et angle du vent réel, sa direction si le cap est fourni, et la VMG (§ 4). Malgré les incertitudes sur les différentes composantes ces indications relatives sont de bons repères pour le réglage des voiles.
7.3.1 Anémomètre
Le système employé est le rotor à coupelles, la vitesse du vent est déduite de celle de rotation (idem que § 7.2.1). La vitesse affichée est entachée d'erreurs : linéarité de réponse imparfaite, vent perturbé par le support de l'appareil (haut du mât ou portique) et variant suivant la hauteur au dessus de l'eau.
7.3.2 Girouette
L'angle d'une pale orientée dans le vent est mesuré par capteurs à effet Hall.
La résolution du degré des afficheurs numériques est illusoire, l'angle est faussé par :
- les perturbations de la voile,
- la torsion du mât (twist) sous l'action des voiles,
- la gîte (possibilité de correction),
- un mauvais centrage du capteur par rapport à l'axe du bateau (compensable sur certains appareils).
7.3.3 Anémomètre / girouette à ultrasons
La vitesse du vent est mesurée suivant deux axes perpendiculaires par des capteurs à ultrasons
(même principe qu'en débitmétrie). Pour chaque axe le temps de transit d'une impulsion entre deux sondes
est mesuré dans les deux sens :
t1 = L / (c + v) et t2 = L / (c - v)
d'où v = L (t2 - t1) / 2 t1 t2
avec L distance entre sondes
Puis les force et direction du vent sont calculées suivant les deux composantes.
Apparu récemment ce capteur est plus précis que les précédents en théorie (linéarité), mais les mêmes
observations s'appliquent... Il présente l'avantage d'être statique, compact et de faible encombrement.
7.4 Sondeur
Principe : mesure du temps de retour d'une impulsion ultrasonore émise par un transducteur
céramique (le plus utilisé, par électro-striction) et donc h = c t / 2 (c = 1450 à 1550 m/s,
soit ± 3 %). La célérité est fonction de
la densité de l'eau, donc de la salinité et de sa température ; mais c'est négligeable en pratique,
la mesure dépend surtout de la verticalité des faisceaux aller et retour.
Les hautes fréquences permettent plus de détails mais l'affaiblissement
est plus important (le son se propage par vibration mécanique du milieu) et limite
l'échelle de profondeur. Celle-ci dépend aussi de la puissance émise, de la durée de
l'impulsion (0,3 millisecondes pour 100 mètres, 1 ms ou plus au delà) et de l'étroitesse du
faisceau (cône d'environ 30°).
L'appareil étant sourd pendant l'émission l'incertitude sur la profondeur sera
fonction de sa durée, par ex. pour 0,3 millisecondes : 0,23 mètres. L'intervalle d'émission est réglé
suivant l'échelle de profondeur afin de ne pas écraser les échos.
Le capteur doit être placé à l'abri des remous. Variantes : faisceau dirigé à 45° vers l'avant (information anticipée), sans passe-coque (au contact à l'intérieur, perte de puissance).
Le plus populaire était le sondeur à éclats (Seafarer™), à deux échelles. Suivant le réglage du gain la forme de l'écho donnait une indication de la nature du fond. Les enregistreurs utilisaient un papier (cher) à défilement mécanique.
Les sondeurs modernes vont du plus simple au plus sophistiqué :
- simple affichage de la profondeur sans réglage (une mesure jusqu'à
100 mètres servira pour les atterrissages, § 3.3.3) ;
- bi-fréquence (50 et 200 kHz, 200 à plus de 1000 W), bi-faisceau (20 et 60°),
réglages divers, affichage sur écran LCD
(couleurs différenciées suivant l'écho), mémorisation des profils...
Enfin, les sonars (par analogie avec le radar) balaient des secteurs horizontaux et verticaux pour rechercher les bancs de poissons.
Remarque : l'absence d'interrupteur coupant le sondeur lorsque celui-ci est inutile (fonds suffisants) est regrettable, les cétacés apprécieraient.
7.5 Pilote automatique
L'appareil comprend
- la partie mécanique agissant sur la barre : vérin électrique ou hydraulique, le mieux étant le montage direct sur le secteur de barre,
- le système de commande : la consigne provient au choix du compas électronique ou du GPS (cap) ou de la girouette (angle du vent, fonctionne en régulateur d'allure),
- et l'affichage du cap suivi et de l'angle de barre.
Initialisation du pilote : se limite en général au repérage des positions zéro et fins de course de la barre.
Consigne de cap : le pilote prend pour référence la valeur fournie par le compas (ou autre) au moment de l'enclenchement ; elle est ajustée ensuite par pas de ± 1° ou ± 10°.
L'asservissement utilise le principe des régulations PID (Proportionnelle, Intégrale et Dérivée), la somme des trois actions pondérées par leurs coefficients (P, I et D) ordonne l'angle de barre nécessaire pour rétablir le cap :
θ° = k (P δ + I ∫ δ dt + D dδ / dt) avec δ = cap - consigne, k = gain global
Le réglage du pilote se fait par ajustement de ces facteurs :
- L'action proportionnelle dose l'angle de barre en fonction de l'écart de cap. Cet angle est limité suivant la vitesse du bateau afin d'éviter une surréaction (dépassement de la consigne de l'autre côté). Le paramètre de "contre-barre" a le même but.
- L'intégrale réagit pour revenir à la consigne tant qu'il y a un écart. Trop d'intégrale provoque des oscillations, pour éviter cela on définit une dead band : écart permis sans correction.
- La dérivée détermine la vitesse de réaction. La détection des écarts par capteur de déplacement angulaire est plus rapide que par le compas, la correction est plus fine ("gyropilot").
- Enfin le trim est le décalage du zéro de la barre.
7.6 Régulateur de vitesse
Utilisé sur les canots de ski nautique, mais pourquoi pas sur d'autres vedettes...
Le capteur de vitesse est la classique roue à aubes mais la tendance est d'utiliser le GPS
(vitesse fond alors que c'est la vitesse surface qui est importante en ski). Les premiers régulateurs
étaient mécaniques (action sur le volet d'admission d'air), maintenant électroniques (comme les automobiles actuelles).
Les modules spécialisés ski ont des possiblités de paramétrage sophistiquées.
7.7 Interfaces et réseaux
7.7.1 NMEA 0183
Cette norme NMEA définit les
communications entre appareils (4 800 bauds, dernière évolution : 0183 HS à 38 400 bauds, initialement en
TTL 0 - 5 volts, en RS 422 depuis la version 2)
et le format des messages contenant les données (ASCII sur 7 bits, 0 à 127). Ce n'est pas un véritable bus :
il peut y avoir plusieurs récepteurs mais un seul émetteur. La connexion à un PC est possible si l'appareil
a une sortie série RS232 ou USB, voir
Connexion GPS - PC.
Il semble que ce standard coexistera avec la 2000 ci-dessous, la version 4 date de 2008.
7.7.2 NMEA 2000
Elle utilise un réseau de type CAN (utilisé par les
contrôles et automatismes industriels et l'automobile) et apporte les améliorations suivantes :
- connexion simple d'un nouvel appareil (jusqu'à 50 connectés au même réseau), la même liaison physique
fournit l'alimentation électrique (sauf pour les gros consommateurs comme le guindeau) et transporte les données ;
- vitesse 250 kbits/s pour une longueur de câble jusqu'à 200 mètres, au delà la vitesse décroit ;
- chaque appareil est à la fois émetteur / récepteur et contrôleur (pas de collisions) ;
- de nouvelles données sont prévues (par ex. : paramètres des moteurs), mais le format des trames est
différent de la 0183, voir
NMEA 2000.
7.7.3 NMEA OneNet
Dernier projet de la NMEA (2013 ?), ce standard utilisera l'Ethernet IEEE 802.3. Le réseau pourra ainsi transporter outre les messages de la 2000 des données graphiques (cartes, images radar et sondeur, caméras de surveillance...) grâce au débit (100 Mb/s contre 250 kb/s), avec un nombre de connexions bien plus élevé.
7.7.4 Réseaux
Il faut enfin citer les bus et réseaux propriétaires (spécifiques) des constructeurs. Certains ressemblent
à du CAN, d'autres sont baptisés Ethernet sans assurance de stricte conformité à l'IEEE 802.3,
proposent du WiFi..., et des passerelles (convertisseurs 0183 - 2000).
Malgré l'effort louable de standardisation de la NMEA, l'inertie du marché : parc installé, réticence des
constructeurs à abandonner leurs propres systèmes, fait que dispositifs standards (la NMEA 0183
a encore de beaux jours devant elle) ou spécifiques co-existeront longtemps. Difficulté du choix d'une
installation, les interfaces de communication proposés sur le marché, séduisants en théorie, rendent l'architecture
de l'instrumentation plus complexe et augmentent les risques de données erronées, voire de pannes.
7.8 Lecteur de cartes
Les cartes électroniques sont soit matricielles (cartes papier numérisées dites
raster ), soit vectorielles. Ces dernières offrent les avantages de choisir
les éléments à afficher et d'y superposer des informations complémentaires. Différents formats :
- norme S57 de l'OHI pour les
ENC, cartes vectorielles officielles des services
hydrographiques (cryptage suivant S63) ;
- BSB (fichiers .kap) devenu un standard de fait pour les cartes matricielles, en clair (v2) ou cryptées (v4) ;
- propriétaires suivant les éditeurs.
Important : vectorielle ou non une carte ne peut offrir plus de détails qu'elle ne contient, le lecteur doit avertir d'un zoom excessif lorsque son échelle est dépassée. Elles doivent être maintenues à jour comme les cartes papier.
Les lecteurs de cartes, combinés avec un GPS, ont plus ou moins de fonctionnalités :
- affichage en temps réel de la position et trace de la route suivie,
- alarmes de cap, profondeur, etc...
- relèvement et distance d'amers,
- way points et routes,
- superposition de l'image radar,
- calculs de marée et affichage des courants de marée,
- affichage des données d'autres instruments connectés (afficheur multiple).
L'alternative est le PC, éventuellement marinisé (voir ci-dessous). Outre la lecture de cartes on pourra utiliser divers logiciels : routage, performances voilier... ou simplement un tableur pour tous les calculs. La tendance moderne est l'afficheur multifonction (lecteur de cartes, sondeur, radar, etc...), en fait un PC spécialisé qui regroupe tout le tableau de bord en un seul appareil.
7.9 Informatique à bord
Un smartphone et un PC portable donnent accès gratuitement à plusieurs fonctions de navigation.
7.9.1 Le smartphone
Appelé ainsi pour ses multiples fonctions (il permet même de téléphoner), un appareil de milieu de gamme sera suffisant en vue des côtes (pochette étanche et flottante obligatoire) pour
- appeler le port, l'écluse, les secours ;
- servir de GPS de secours, même au large, par ex. l'application Polaris Navigation ;
Connecté à internet (option "données mobiles") pour :
- consulter le web : la météo, les marées (site marée.info) ;
- afficher une cartographie avec votre position : application C-MAP Embark ou Wase pour le fluvial (attention, ne pas accorder une confiance aveugle malgré la bonne précision constatée de ces deux applications) ;
- servir de modem au PC.
7.9.2 Le PC
A garder à l'abri des embruns, loin des doigts mouillés et des cirés dégoulinants. Sans connexion internet :
- L'outil indispensable est le tableur (feuille de calcul), par ex. Open Office gratuit (compatible avec MS Office), pour tous les calculs (voir les différentes rubriques).
- Pour la navigation astronomique les éphémérides du Soleil de Navastro.fr et calculs avec le tableur ; plus besoin de starfinder pour les étoiles, le superbe logiciel Stellarium situe les étoiles utilisées en astro : en pointant dessus le programme affiche les hauteur et azimut (entrer la position et l'heure), il n'y a plus qu'à calculer l'intercept.
- Pour la cartographie : OpenCPN (brancher une souris GPS en USB), avec plusieurs fonctions et affichage des cibles AIS si un récepteur est connecté. Lit les cartes officielles du SHOM ou d'autres éditeurs, payantes, ou des cartes gratuites dont on se méfiera de l'exactitude.
Avec connexion internet :
- Récupérer les fichiers météo en format GRIB à l'aide de zyGrib.
- Le logiciel de routage QtVlm (non testé) offre des fonctions de navigation similaires à OpenCPN plus des modules de lecture des GRIBs et de routage.
- Enfin Google Earth fournit des vues aériennes très instructives qui complètent les cartes.
© G. Navarre, 2006. Màj 10/07/2023.